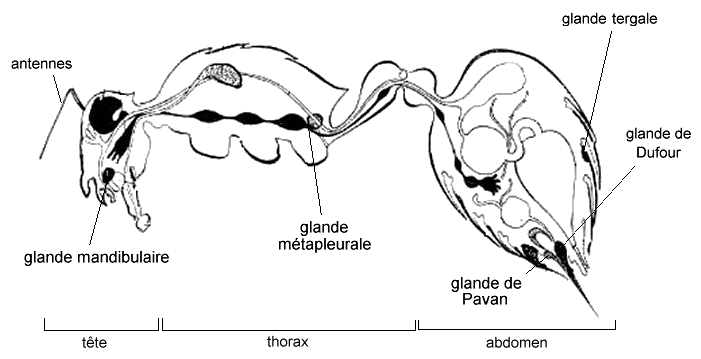Les moyens de communication
Les moyens de communication chez la fourmi sont aussi nombreux que chez les Hommes, elles utilisent les mêmes sens mais parfois différemment. Nous pouvons dire que la plupart d'entre eux sont relativement peu développés, comme par exemple la communication visuelle. Elles utilisent également les sons, mais d'une manière différente des humains. Il existe également une communication tactile chez les fourmis.
A- Les moyens les moins développés
La vue fait partie d'une de leur manière de communiquer, les fourmis peuvent "danser" pour attirer l'attention des autres ou encore tourner autour d'un objet pour recevoir de l'aide afin de le déplacer. Cependant leur vision n'est pas optimale, ce qui minimise son utilisation. Elles voient une image composée de la lumière captée par la centaine de facette composant chacun de leurs deux yeux. Les reines et les mâles ont aussi trois ocelles sur la tête qui perçoivent les infrarouges afin de détecter les sources de chaleur (disposées en triangle, cf image ci-dessous)
Schéma d'une tête de fourmi
La communication sonore est aussi utilisée chez les fourmis mais d'une manière différente des humains, en effet elles interceptent les vibrations du sol émises par leurs congénères grâce à leurs pattes très sensibles, elles sont donc sourdes mais pas muettes! Pour créer ce son qui fait vibrer le sol, les fourmis frottent leurs antennes sur leur abdomen plein de crêtes, ce son est appelé stridulation, et la partie qu'elles frottent avec leurs antennes est l'organe stridulatoire. Elles peuvent aussi (rarement) frapper avec une partie de leur corps pour faire se propager les vibrations. Ce système est utilisé pour les cas de détresse ou pour donner des information sur une nouvelle source de nourriture.
Le second moyen de communication le plus utilisé est la communication tactile. Les fourmis se frottent les antennes entre elles, sur le corps ou les antennes, pour collecter des informations, elles s'identifient (âge, caste, espèce, colonie, numéro de ponte : vidéo ci-dessous). Elles peuvent aussi mettre la patte sur le labium d'une congénère (langue chez les fourmis) afin d'engager la trophallaxie. Celle-ci permet de s’alimenter et de créer l’odeur propre à chaque fourmilière.
Des fourmis de notre colonie se reconnaissent à l'aide de leurs antennes pendant qu'elles s'organisent pour manger une mouche (une fois en haut à droite et une autre en bas a gauche)
Les antennes servent aussi à recevoir des phéromones, leur meilleur moyen de communiquer.
B- Le principal moyen de communication
Le moyen de communication le plus utilisé par les fourmis reste le système olfactif : les phéromones en sont la base. Ce sont des molécules émises par les fourmis, qui leur permettent de transmettre des idées, des émotions, des ordres également. Les fourmis peuvent en produire entre 10 et 20 différentes selon les espèces. Seules les fourmis peuvent percevoir les informations émisent par d'autres fourmis grâce à leurs antennes qui recoivent chaque phéromone séparément (chaque segment/article est apte à recevoir une phéromone).
Schéma légendé Schéma légendé du corps d'une fourmi
d'une antenne de fourmi
1. Différents types de phéromones : les phéromones principales
Il existe une multitude de phéromones, nous allons en étudier quelques unes. Les plus utilisées sont les phéromones de piste et les phéromones d'alerte. Il existe aussi les phéromones de territoire (elles délimitent les territoires des colonies, ainsi que les entrées et sorties), les phéromones d'agrégation (elles permettent à certaines fourmis d'en attirer d'autres, les reines l'utilisent souvent), les phéromones passeport (qui permettent l'identification de l'individu) les phéromones de recrutement (permet de se répartir les tâches et de s'organiser) et les phéromones sexuelles (utiles aux mâles et aux femelles lors de l'accouplement).
Comme nous l'avons déjà expliqué, les fourmis possèdent un grand nombre de phéromones. Contrairement aux humains qui en sont moins bien équipés, ce sujet sera développé dans la seconde partie.
On remarque aussi que certaines phéromones sont repérées grâce au goût (ce qui est illustré dans Les Fourmis de Werber, par exemple). Mais celles-ci sont négligeables par rapport à la quantité de phéromones olfactives.
2. Zoom sur deux types de phéromones pour mieux étudier le phénomène : les
phéromones de piste et d'alerte
En étudiant la structure moléculaire de certaines phéromones, nous remarquons que la plupart possèdent deux types de groupements :
• Les cétones
On remarque ces groupes grâce à la liaison C=O qui les
compose. Selon ce qui les entoure, les cétones sont capables de produire
différentes odeurs. Pour l'acétone (isomère CH3 - C=O - CH3), on obtient une odeur fruitée; dans le cas du butanone (C4H8O), on peut remarquer une odeur plus piquante, agressive. Ainsi les messages transmis sont différents.
• Les esters
Les esters sont d'autres types de groupements, beaucoup plus complexes. On les remarque grâce à une structure R - O-C=O - R'
(voir figure ci-jointe), où R désigne la continuité de la molécule.
Ils dégagent souvent des parfums fruités. On peut les obtenir à
l'aide d'une esterification, qui consiste à faire agir un acide sur un
alcool, dans le but d'obtenir de l'eau et des esters.
On peut également remarquer que les phéromones sont organiques (molécules principalement composées d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote).
Nous pouvons observer ceci avec beaucoup de phéromones. Par exemple certaines fourmis utilisent la molécule d'octanal C8H16O en tant que phéromone d'alerte. Cette molécule est en effet organique et se compose d'une double liaison C=O, qui met en évidence la présence d'une cétone.
Pour prendre un autre exemple, nous pourrions citer l'une des phéromones de pistes utilisées par les fourmis: la molécule C7H11ClN2O2. Encore une fois, nous avons affaire à une molécule organique, et elle possède un groupement ester.
Dans Les Fourmis, Werber nous offre une liste (non exhaustive) de quelques autres molécules utilisées comme phéromones (comme le Méthyl-6, le méthyl-4-hexanone-3, l'acétone, l'octanone-3...)
Maintenant que nous connaissons le fonctionnement de base des phéromones, nous allons pouvoir nous concentrer sur des cas particuliers.
a) Les phéromones de piste
Ce sont les phéromones les plus connues. On connaît tous la situation: un pique-nique sur l'herbe. Tout se passe pour le mieux lorsqu'une longue chaîne de fourmis débarque et commence à se servir dans votre déjeuner.
Cette chaîne d'insectes est le résultat de l'utilistion des phéromones de piste. Ces dernières permettent aux fourmis de tracer un chemin entre un point A (en général la fourmilière) et un point B (ici une source de nourriture) qui peut être n'importe où. Il existe d'autes phéromones indiquant une sorte de sens interdit (pour dire qu'il n'y a rien dans cette direction), les autres indiquent vraisemblablement la direction vers une source de nourriture ou bien d'autres ressources utiles (notamment des matériaux utiles à la construction du nid).
Ces pistes existent si elles sont assez souvent utilisées par les membres de la colonie. En effet, si une piste n'est pas empruntée régulièrement, les phéromones qui la composent s'évaporent. Selon les espèces, les phéromones ne sont pas libérées de la même manière: des phéromones posées à même le sol (état liquide de la molécule) tiennent longtemps et favorisent les trajets quotidiens alors que des phéromones volatiles (gazeux) permettent un recrutement massif et rapide. Cependant celles-ci disparaîssent plus rapidement. Autre fait intéressant, les phéromones produites par la fourmi peuvent indiquer simultanément plusieurs informations telles que la qualité, le type et la quantité de nourriture.
Dans notre expérience (une fourmilière que nous avons observée sur la longue durée), nous avons remarqué que les fourmis pouvaient se suivre pour aller chercher des matériaux. Elles prennent alors presque toutes le même chemin. Nous vous conseillons d'activer la HD.
b) Les phéromones d'alerte
Elles sont utilisées en cas d'attaque de la fourmilière ou en cas d'accident: elles servent donc pour signaler une urgence. Les fourmis utilisent ces signaux chimiques (souvent de courte durée et gazeux) ainsi que des substances défensives telles que l'acide formique, aussi connu sous le nom d'acide méthanoïque, de formule CH2O2. Lorsqu'elle est attaquée, la fourmi arrose son ennemi de cet acide (certaines espèces n'ont cependant pas cette capacité). Ce qui lui sert de moyen de défense mais aussi de système d'alerte pour que des congénères lui viennent en aide.
Une molécule d'acide méthanoïque (formule semi-développée)
Les phéromones d'alerte sont élaborées dans différentes glandes et notamment dans les glandes mandibulaires (voir schéma au début du B.). Ce qui explique pourquoi on peut observer des fourmis avec les mandibules écartées lors de cas d'urgence.
Chez les fourmis coupeuses, les phéromones d'alerte se présentent sous la forme C8H16O. Cette molécule est liquide. Et nous pouvons déduire qu'elle est incolore et qu'elle dégage un parfum fruité.
Nous pouvons donc affirmer que la fourmi communique activement avec ses congénères via divers moyens (visuels, tactiles, sonores) même si elle semble privilégier la communication chimique. Sans doute car les phéromones sont nombreuses. Elles permettent la pérennité, la sécurité et la survie de l'espèce ainsi que la bonne cohésion de la fourmilière grâce à la diversité d'informations. Nous allons étudier l'utilité de cette communication au sein de la fourmilière et nous en profiterons pour voir les similitudes que la fourmis possède avec l'Homme.